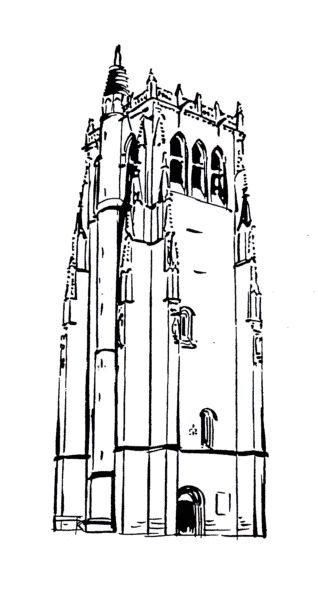Toutes les traditions religieuses doivent en effet s’interroger sur Dieu par la raison. Nombre d’entre elles sont loin de s’en être fait une obligation. Pis encore, le regain de religiosité qu’on observe dans le monde ne se manifeste souvent qu’à travers les formes de foi les plus dégradées et les moins compatibles avec le caractère, essentiellement scientifique, des sociétés contemporaines. D’où les craintes qu’on peut nourrir sur le caractère fragile et, à terme, risqué, de ces tentatives de renouveau dont la composante pentecôtiste est volontiers revendiquée.
La recherche sur Dieu a pris un tour inédit dans les deux derniers siècles. La réflexion théologique s’est enrichie de l’étude historico-critique des textes où s’exprime la foi en la divinité. Ces textes eux-mêmes ne sont plus regardés comme s’ils pouvaient contenir des éléments dont l’historicité matérielle nous apprendrait quelque chose de positif sur Dieu. On s’est réorienté vers l’étude littéraire de ces témoignages écrits : à quelle fin ils ont été composés, par qui, dans quelles langues et quels milieux de vie, sous quelles formes, pour répondre à quelles questions, quels événements, quels usages, quels besoins, et, à partir de là, de quels caractères du Dieu de la foi témoignent-ils.
Cette étude s’est focalisée en Europe sur la Bible hébraïque et sur les écrits évangéliques ; mais elle a rapidement gagné les textes sacrés de toutes les religions non sans s’exposer à de brutales intimidations. Ce n’est pas seulement la direction du regard scientifique qui a changé mais les objets sur lesquels il se pose. Parallèlement, c’est en revenant aux « attributs » de Dieu non plus seulement tels que la métaphysique classique les définit par abstraction ou le dogme par tradition mais tels qu’ils se dégagent des textes que les théologiens ont remis la réflexion sur le métier. La théologie traditionnelle n’en a pas été abandonnée pour autant : au contraire, la réflexion s’est nourrie de la complémentarité des deux courants.
L’exégèse critique des textes sacrés n’est pas seulement un enrichissement : elle offre à la théologie, à l’apologétique, à la pastorale une approche solide pouvant être partagée dans un cadre rationnel. La tradition, depuis Origène, avait reconnu aux Écritures quatre sens possibles : le sens littéral, le sens allégorique, le sens moral, le sens anagogique ou mystique. Il faut en ajouter un cinquième : le sens « critique ». Plus encore, c’est celui à la lumière duquel les autres doivent désormais s’ordonner.
En voici deux exemples, le premier tiré de la Bible hébraïque, le second des Évangiles.
La Genèse (19, 1-29) rapporte le sort des habitants de Sodome dont la ville est, selon l’interprétation traditionnelle, anéantie par Yahvé en raison de leur péché contre nature à l’égard des deux anges qui leur sont envoyés. Une lecture critique montre d’abord que Lot, un habitant de Sodome chez qui les deux messagers ont reçu l’hospitalité, leur propose ses filles en échange du salut de ses hôtes comme s’il savait que la proposition pouvait néanmoins les satisfaire, mais surtout parce qu’il préfère livrer ses filles plutôt que de manquer au devoir de l’hospitalité : telle est la pointe du récit. En refusant tout compromis, les habitants de Sodome contreviennent à la loi du Deutéronome dont l’influence sur la rédaction du passage est manifeste : Yahvé aime l’étranger auquel il donne pain et vêtement. Aimez l’étranger car au pays d’Égypte, vous fûtes des étrangers. Telle est l’explication du châtiment de la ville.
L’étude historique des interprétations du texte montre que la lecture traditionnelle est tardive. L’historien juif Flavius Josèphe l’ignore encore au 1er siècle et s’en tient à celle de l’inhospitalité des habitants de Sodome : « Ils haïssaient les étrangers et fuyaient toute relation avec autrui. Irrité de cette conduite, Dieu décida de châtier leur insolence, de détruire leur ville et d’anéantir le pays au point qu’aucune plante, aucun fruit n’en pût naître désormais. » Cette lecture n’apparaît pas avant le troisième ou quatrième siècle de notre ère, sous l’influence du combat des chrétiens contre le paganisme où les relations sexuelles entre personnes de même sexe, sous certaines conditions, appartenaient à la vie courante.
Encore à l’époque de Jésus, le châtiment de la ville n’était pas interprété comme la conséquence de relations sexuelles interdites mais, de nouveau, comme celle de la violation des lois de l’hospitalité. Un passage de l’évangile le confirme dans la bouche de Jésus lui-même : « Lorsqu’on ne vous [les disciples] recevra pas et qu’on n’écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité : au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là ».
En effet, les disciples de Jésus comme les lis des champs ne travaillent ni ne filent : ils comptent pour vivre sur l’hospitalité des croyants partout où ils passent. Le rédacteur de l’évangile, dans la seconde moitié du 1er siècle, n’en doute donc pas davantage : l’histoire de Sodome est celle de la violation des lois de l’hospitalité et rien d’autre. L’actuel croyant qui s’arrête à l’interprétation traditionnelle passe à côté non seulement du message biblique sur l’hospitalité mais du message de Jésus sur la mission.
Autre exemple de lecture critique. La parabole du semeur dans les trois évangiles synoptiques offre une énigme dont peu s’aperçoivent à défaut d’une lecture éclairée. Pourquoi le semeur répand-il son grain sur une terre en friches, semant ainsi au milieu des ronces, des pierres et sur le chemin qui borde ou traverse le champ ? On commence normalement par labourer, herser, puis on sème. Or, dans la Palestine d’alors, on sème puis on laboure, ce qui, par parenthèse, atteste l’enracinement de la parabole dans le monde agricole du temps de Jésus. C’est à la fois le contraire de nos habitudes et, faute de le savoir, l’occasion d’un contresens. Il apparaît même que le semeur n’a nulle intention de labourer. En effet lorsque le grain tombe entre les ronces desséchées, un labourage les déracinerait ; et elles ne pourraient étouffer le grain comme l’assure l’évangéliste.
Le semeur n’est pas non plus très soigneux : chez Marc et Mathieu, il lance le grain à la volée sur le chemin voisin où les oiseaux viennent le picorer ; chez Luc, il le lance sur le chemin tracé à travers champ par le passage des paysans sous les pas desquels il sera, de surcroît, piétiné. Certes, il ne peut deviner les endroits où seule une fine couche de terre recouvre du rocher et où le grain faute de racine sera brûlé par la chaleur ; mais seul celui qui est tombé dans la bonne terre donnera du fruit. Le semeur sème donc au hasard et sans beaucoup de soin, contrairement à l’explication de la parabole attribuée à Jésus mais qui est une glose manifeste de la communauté rédactrice du texte : c’est à dessein que le semeur jette son grain ici ou là pour éprouver le terrain sur lequel il tombe, dit en effet la glose, probablement dans des temps où la communauté était persécutée et où il fallait encourager ceux qui résistaient.
Mais le sens de la parabole en est radicalement renversé : dans sa version d’origine, Dieu ne prédestine personne au châtiment mais répand le grain partout alentour : à chacun de le recevoir là où il est ; dans sa version communautaire, il appelle tout le monde afin de discerner entre ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas.
L’étude critique des textes sacrés est toute récente dans leur longue histoire. Elle ne les expose pas tant à de nouvelles interprétations qu’à des interprétations renouvelées. Aussi ne saurait-on négliger la remise en cause des représentations ordinaires de la foi à laquelle elle mène inévitablement. Si nous sommes croyants, en quoi une vérité que nous n’aurions pas vue autrement devrait-elle nous effrayer ? Et pourquoi ne devrions-nous pas nous féliciter au contraire de disposer d’une meilleure intelligence de la Parole de Dieu dont nous ne saurions nous tromper sur le sens qu’à notre détriment ?
Gérard Cohen
Oblat du Bec, Osb