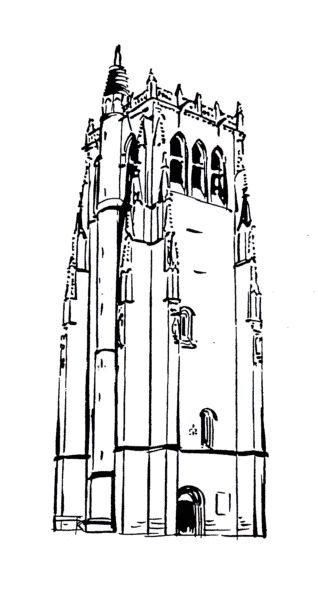[vc_row css_animation= » » row_type= »row » use_row_as_full_screen_section= »no » type= »full_width » angled_section= »no » text_align= »left » background_image_as_pattern= »without_pattern »][vc_column width= »1/2″][vc_separator type= »normal » transparency= »0″ thickness= »15″][vc_column_text]Dimanche 13 novembre :
Pour pouvoir servir les frères sans récriminer, celui qui sert doit recevoir un peu plus. Ce supplément, saint Benoît l’envisage ici comme un supplément alimentaire, mais on pourrait aussi considérer qu’il puisse s’agir d’un supplément de considération, d’affection, de respect. Celui qui sert a besoin de voir son service reconnu, apprécié, pour continuer à travailler avec tout son cœur, dans la joie du service.
Ainsi, il arrive souvent que les frères, ou les supérieurs, considèrent comme un dû le travail accompli par un frère. Et ce dernier, à force de ne recevoir, ni considération, ni remerciement, peut finir par en concevoir du découragement, de l’amertume même. Nous ne nous rendons pas toujours compte à quel point nous pouvons être exigeants ! Cela est vrai pour chacun de nous car nous oublions tous, trop facilement, que nos frères se dépensent sans compter pour nous, qu’ils nous donnent leur énergie, leur jeunesse, leur compétence, parfois en allant jusqu’au bout de leurs forces, et tout cela, tout simplement pour l’amour de Jésus.
Alors, avant de réagir, de réclamer ou de critiquer, il est peut-être sage et honnête de commencer par nous demander si nous avons su dire merci et rendre à notre frère l’honneur qui lui est dû pour tout le mal qu’il s’est donné pour nous.
Une réflexion personnelle du copiste : ces remarques peuvent très bien s’appliquer aux familles et dans les couples où parfois les femmes sont au service des hommes sans plus de considération que ci-dessus ![/vc_column_text][vc_separator type= »normal » transparency= »0″ thickness= »20″][/vc_column][vc_column width= »1/2″][vc_single_image image= »32071″ img_size= »full » add_caption= »yes » alignment= »center » qode_css_animation= » »][vc_separator type= »normal » transparency= »0″ thickness= »55″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation= » » row_type= »row » use_row_as_full_screen_section= »no » type= »full_width » angled_section= »no » text_align= »left » background_image_as_pattern= »without_pattern » background_color= »#ffffff » side_padding= »5/5″ z_index= » »][vc_column][vc_column_text]XXXVI. DES FRÈRES MALADES.
Lundi 14 novembre :
Pour saint Benoît, le malade, c’est le Christ. Mais on pourrait aussi compléter cette affirmation par une autre remarque, tout aussi juste : celui qui soigne les malades, qui prend soin d’eux, suit le Christ dans la communauté, le Christ médecin, le Christ compatissant. toute
Ainsi, dans la communauté, il y a le Christ souffrant, le Christ humble, le Christ pauvre ; il y a le Christ médecin, le Christ doux et humble de cœur, le Christ plein de compassion et d’amour. Dans les soins du malade, c’est toute l’histoire du salut qui se joue de nouveau sous nos yeux. Les malades, comme ceux qui les servent et les soignent, touchent du doigt, et on pourrait dire à pleines mains, le mystère du Christ. Et c’est dans cette rencontre de celui qui sert, et de celui qui a besoin d’être servi, que se révèle, d’une manière particulière, le mystère même de Dieu qui est amour.
Bien souvent, nous envisageons uniquement la question des soins aux malades sous l’aspect des compétences, du professionnalisme des soins, de l’efficacité du traitement. Et nous oublions bien souvent cette part d’humanité et de sollicitude, de bonté et de gratitude qui est essentielle. Pour saint Benoît, il n’en va pas ainsi ! Pour lui, ce qui compte avant tout, c’est le mystère du visage de Dieu qui est dévoilé dans celui qui souffre et dans celui qui lui vient en aide. C’est la parabole du bon Samaritain qui est évoquée ici.
XXXVII. DES VIEILLARDS ET DES ENFANTS.
Mardi 15 novembre :
En fait, saint Benoît ne parle pas ici d’indulgence, mais de miséricorde, et il en profite pour en décrire les traits essentiels. Ainsi, la miséricorde consiste à prendre en considération la faiblesse d’autrui : il s’agit principalement de l’âge, la jeunesse comme la vieillesse, mais cela peut recouvrir également bien d’autres domaines. En fait, la miséricorde commence quand on accepte que l’autre, pour de multiples raisons, soit différent de moi. La capacité d’être miséricordieux est donc intimement liée à l’expérience de l’altérité.
Les conséquences de cette expérience, qui vient des profondeurs de l’être humain, sont décrites par saint Benoît dans le dernier verset de ce chapitre : le latin parle de « pia consideratio » que le traducteur a rendu par « égards (ou considération) et bonté ». Ainsi, la marque principale de la miséricorde, c’est le respect plein de bonté, c’est la bienveillance.
Nous considérons souvent la miséricorde comme une faiblesse, parce que nous craignons d’encourager ainsi le laxisme ou la jalousie, et le danger est réel. Mais la solution ce n’est pas de refuser la miséricorde, mais bien plutôt d’amener chacun des frères à faire l’expérience de l’acceptation de la faiblesse de l’autre, en acceptant d’abord sa propre faiblesse, en n’ayant plus peur de ses propres limites, parce que c’est ainsi que Dieu nous aime, depuis toujours.
XXXVIII. DU LECTEUR DE SEMAINE.
Mercredi 16 novembre :
[..] Le rôle de la lecture est bien d’édifier, de construire la communauté, et cela dans un double sens : d’abord à titre individuel, pour chacun d’entre nous ; et ensuite, de façon collective, pour la communauté en tant que corps. Ainsi, la lecture doit-elle nous édifier car le problème auquel nous sommes vite confrontés dans la vie monastique, c’est la valse des pensées. Pour Cassien, comme pour toute la tradition des Pères du désert, nous ressemblons à une espèce de moulin qui tourne sans arrêt. Et puisqu’il ne peut s’arrêter, il vaut mieux y mettre du bon grain plutôt que d’y broyer des mauvaises pensées, du noir ou de l’ivraie. Il vaut donc mieux fournir à notre âme un aliment substantiel qui la recrée et la reconstitue du dedans.
La seconde dimension de la lecture concerne ce qui enrichit la communauté. Une lecture commune crée peu à peu une culture commune, un langage commun, un univers commun de sensibilité et de réflexion. Une parole écoutée ensemble, des gestes faits ensemble, cela tisse un lien communautaire qui dépasse de loin ce que nous en percevons au premier abord. C’est Dieu qui reconstruit à travers ces réalités chacun de nous, ainsi que la communauté dans son ensemble comme êtres de communion, une Église au sens fort du mot.
XXXIX. DE LA MESURE DE NOURRITURE.
Jeudi 17 novembre :
Saint Benoît consacre trois chapitres à la nourriture, sans compter celui du Carême, ainsi que dans d’autres passages comme au chapitre 51. La nourriture tient donc une très grande place dans la Règle, comme elle en tient une dans la vie du moine. Alors que dans la vie civile, la nourriture n’a pas une place importante, voilà que dans la vie monastique, l’idée d’être privé de quelque chose peut devenir angoissant et source de conflit. Pourquoi ce changement ?
En fait, la vie monastique, par le processus de simplification dans lequel elle nous fait entrer, éloigne peu à peu tous les faux problèmes qui nous distrayaient. Elle nous ramène au cœur même de notre humanité. En nous tirant vers l’essentiel, elle nous ramène aux fondements de nos désirs primordiaux. Il ne faut, ni s’en étonner, ni s’en inquiéter ; c’est plutôt bon signe, car la vie monastique est un chemin ‘’d’évangélisation des profondeurs’’. Et cette évangélisation doit transformer tous les instincts qui nous habitent et demeurent cachés la plupart du temps, même à nos propres yeux.
La peur de manquer est révélatrice d’une autre peur, bien plus profonde celle-là, cette angoisse ‘’d’être’’ qui habite tous les hommes. Apprendre à ne plus avoir peur de nos peurs, tel est le but du jeûne et de toutes formes d’ascèse. Car l’ascèse est, avant tout, une école de liberté, libération de nos peurs les plus profondes et les plus secrètes.
- DE LA MESURE DE BOIRE.
Vendredi 18 novembre :
Qu’on s’abstienne de se plaindre, ou plus exactement ne pas murmurer, voilà une des règles fondamentales de la vie monastique. Dans ce chapitre 40, elle s’applique aux conditions de lieux qui feraient qu’on ne peut se procurer de vin, mais saint Benoît aime à répéter cet adage dans d’autres situations. En effet, il est toujours possible de murmurer pour de nombreuses raisons : contre les circonstances et les évènements, contre les autres ou le supérieur, contre soi-même et ses propres limites !
Le murmure est donc le signe extérieur d’un refus bien plus fondamental. On en veut toujours à quelque chose ou à quelqu’un, ou encore à soi-même, parce qu’on n’arrive pas à accepter les limites de l’existence, parce que, au fond, on voudrait être ‘’tout’’, et que c’est impossible. Il ne s’agit pas d’un problème moral, d’un manque d’humilité ou d’une marque d’orgueil, car nous passons tous, un jour ou l’autre, par cette porte étroite, ce chemin escarpé, où il faut accepter de perdre bien des illusions et des rêves de grandeur. Ce passage étroit, ce trou d’aiguille, nous devons le traverser à divers moments de notre existence ; mais au fond, c’est toujours la même expérience.
Cette expérience se présente essentiellement sous deux visages : un visage négatif d’abord, car on y ressent une extrême impuissance, on n’en peut plus ! Mais elle a aussi un visage positif, car lorsqu’on est confronté à l’impossible, Dieu intervient ! Alors Il nous fait passer de l’autre coté du mur sans que nous ayons vraiment conscience du chemin où Il nous conduit. Nous faisons alors l’expérience d’être sauvés, l’expérience intime du salut.
Au cours de cette vie, ce n’est jamais une expérience définitive. Il y aura toujours de nouveaux seuils à passer jusqu’à cet ultime seuil, la mort, qu’Il est le seul à pouvoir nous faire traverser [et où Il nous accueillera].
XLI. À QUELLES HEURES SE PRENNENT LES REPAS.
Samedi 19 novembre :
Dans ce chapitre consacré au jeûne, saint Benoît commence par considérer le temps où il n’est pas question de jeûne : de Pâques à Pentecôte. Pui il introduit diverses modalités de jeûne avec un crescendo. D’abord, en temps ordinaire, les mercredi et vendredi, on retarde l’heure du repas du milieu du jour après None. Puis, du 14 septembre au Carême, le repas est pris après None tous les jours. Et enfin, durant le Carême, le repas sera partagé après Vêpres.
Saint Benoît considère le jeûne, non sous l’aspect de la quantité ou de la qualité des aliments, mais plutôt par rapport à l’heure du repas. La dimension essentielle du jeûne, dans ce chapitre, est donc celle de l’attente, de l’éveil du désir. On désire que le temps passe, on regrette que le temps soit long. Tandis que dans le temps pascal, il s’agit d’une sorte d’accomplissement, d’expérience du temps qui est déjà là.
Cette dimension d’attente place automatiquement la vie du moine ‘’dans une perspective eschatologique’’. Nous vivons dans un temps d’attente, d’inachèvement, de perception de nos limites.
Mais saint Benoît replace à nouveau cette attente dans une démarche monastique, c’est-à-dire d’obéissance [..] Nous avons tous fait cette expérience que, lorsqu’il s’agit de faire ce que nous avons choisi nous-même (jeûne ou autre chose), même si c’est quelque chose de très difficile et vertueux, c’est toujours plus facile que de faire une chose parfois beaucoup plus légère, mais par obéissance. Cela fait penser à Naaman le Syrien venu voir Élisée (2 Roi 5, 1-15a), et à la réaction de ses compagnons : « Père ! Si le prophète t’avait ordonné quelque chose de difficile, tu l’aurais fait, n’est-ce-pas ? Combien plus, lorsqu’il te dit : ‘’Baigne-toi trois fois et tu seras purifié.’’ »
Les petites choses de la vie quotidienne, dans l’obéissance, nous semblent parfois mille fois plus pénibles que de grandes austérités. Peut-être est-il beaucoup plus difficile de ne prendre que du pain sec au petit-déjeuner plutôt que de ne rien manger jusqu’au soir ?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]