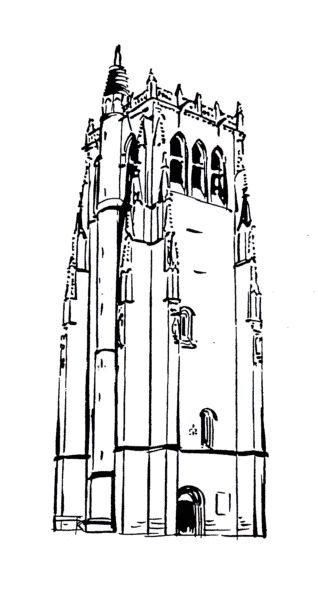[vc_row css_animation= » » row_type= »row » use_row_as_full_screen_section= »no » type= »full_width » angled_section= »no » text_align= »left » background_image_as_pattern= »without_pattern »][vc_column width= »1/2″][vc_column_text]Du colosse aux pieds d’argile
Pour contrer la pandémie du coronavirus, les moines et les moniales sont, comme tout le monde, confinés dans leurs monastères. Confinement relatif, à la différence de bien des gens, vu la surface de leurs habitations et l’espace de leur environnement ; relatif, surtout, du fait qu’ils ont déjà choisi une forme de confinement, qu’ils appellent stabilité, désert, solitude.
Le retrait, le cloître, qui s’impose à tous, aujourd’hui, est leur quotidien, avec bien sûr quelques exigences supplémentaires, ne serait-ce qu’eux aussi, pouvant être atteints par le virus, doivent se protéger et rester prudents : dans toutes les abbayes, on n’occupe qu’une stalle sur deux, au chœur, on espace les frères ou les sœurs au réfectoire, on évite de se frotter les uns aux autres, ce qui a l’avantage de limiter les heurts, dans tous les sens du terme…[/vc_column_text][vc_separator type= »transparent » thickness= »30″][blockquote text= »Une toute petite chose de rien du tout (le mot est d’un penseur africain) a renversé, en un instant, le géant aux pieds d’argile qu’est le monde industrialisé. » show_quote_icon= »yes »][vc_separator type= »transparent » thickness= »30″][/vc_column][vc_column width= »1/2″][vc_single_image image= »20476″ img_size= »full » alignment= »right » qode_css_animation= » »][vc_separator type= »transparent » thickness= »30″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation= » » row_type= »row » use_row_as_full_screen_section= »no » type= »full_width » angled_section= »no » text_align= »left » background_image_as_pattern= »without_pattern »][vc_column][vc_column_text]Mais ce billet n’a pas l’intention de donner en exemple les communautés monastiques, pour inciter les gens à rester confinés ; il voudrait ouvrir une réflexion plus large, à l’occasion de l’épidémie qui menace la terre, depuis plusieurs mois et pour de longues semaines encore : Une toute petite chose de rien du tout (le mot est d’un penseur africain) a renversé, en un instant, le géant aux pieds d’argile qu’est le monde industrialisé.
Tout déplacement est interdit, l’industrie s’est arrêtée, le commerce est en berne, la bourse recule, les politiques tremblent, chacun se calfeutre chez soi, en attendant que la vague passe… Il paraît qu’on voit, dans les villes, depuis quelque temps, des cols verts, comme le faisan que j’ai dû éviter, l’autre jour, dans la grand-rue de Pont Authou, près de la Pharmacie. La nature reprendrait ses droits, chassée quelle était depuis des décennies par le béton, le macadam, les voitures et la presse des piétons affairés. L’air s’est assaini, avec la diminution de la pollution.
Derrière ses rideaux, on retrouve donc le loisir de regarder par la fenêtre ce qui se passe dehors ; on se prend à penser ; on se demande comment on pouvait encore courir, il y a dix jours, sans savoir pourquoi ni où on allait ; on ose imaginer des lendemains autres, où on ne courra plus, parce qu’on laissera venir les jours. Et, au fil de cette retraite forcée, on en vient à analyser les causes de ses essoufflements et de ses inquiétudes passés : comment se fait-il que je m’adapte si facilement au confinement ? Pourquoi ce dont j’avais un besoin urgent hier, me paraît-il aujourd’hui, non pas inutile, mais pouvant bien attendre ?
J’appréhenderais presque de redémarrer, dans quelque temps, comme avant… Non des moindres, et de toutes couleurs, ont dit, ces jours-ci, qu’il y aurait un avant et un après la crise… Ce serait souhaitable, mais un fin politologue a ajouté : « Oui, à condition que la crise dure un peu ». Pourrons-nous, demain, maîtriser nos besoins, les hiérarchiser, les échelonner, les reporter, même ? Serons-nous capables, après ce temps de recul et de réflexion, de discerner ce qui construit une société et ce qui la détruit ? Saurons-nous voir, ayant partagé la fragilité de tous les humains, riches ou pauvres, les injustices, les exclusions, les parti-pris que nous feignions d’ignorer, hier ? Et surtout, surtout, ces longues semaines nous auront-elles vaccinés contre tous les virus qui circulent dans nos sociétés hyper branchées et polluées, dont nous ne savions même pas qu’il s’agissait de virus ?
On parle bien d’avoir le virus de la chasse ou du football, des timbres ou des cartes postales. C’est gentil et sans conséquences ! Je parle de vrais virus, qui nuisent, dépersonnalisent, rendent esclave… Pas les addictions que sont le sexe, la drogue, l’alcool ou le tabac, les smartphones, à la limite, mais les outils ou moyens géniaux dont nous usons quotidiennement et qui risquent de nous user, si nous n’y prenons garde : le net, la publicité, l’argent, la technique, le pouvoir, toutes choses excellentes si elles servent à améliorer les relations et les communications, à générer du travail, à organiser au mieux la vie en société, mais qui peuvent aussi devenir dévoreuses de temps, drogues dures, source de dérives graves. On est alors infecté, comme d’un mal incurable qui devient très vite contagieux, si on n’a pas conscience de leur nocivité.
Les moines et les moniales, qui passent leur vie confinés, ont donc le loisir, à la longue, de déjouer les pièges de ces outils tellement fascinants qu’ils se font prendre pour des dieux et cachent en fait des démons, je veux dire des virus. Eux aussi doivent se protéger, trouver des gestes barrière, garder de la distance face à ces microbes : on n’a pas internet en cellule, on demande l’argent dont on a besoin, on n’est pas propriétaire de sa charge, on est dépendant en tout les uns des autres. Les écarts, il y en a ; les reculs et les chutes, o combien ! Mais les autres nous reprennent, et on repart. « Un moine, disait un ancien, c’est un homme qui tombe et se relève ».
Si le coronavirus nous alerte sur l’existence d’autres virus aussi nocifs et même plus mortels, sa séquence nous aura au moins appris à nous défendre, et nous serons vaccinés contre le virus du progrès, celui de la consommation, celui de la finance et du relativisme…
Fr. Paul-Emmanuel
Abbé du Bec[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]